La fragilité des tabous
La censure fragilise les idées. C’est le débat qui les rend résistantes.

Il y a apparemment des gens à travers le monde qui croient que la Terre est plate.
(J’écris apparemment parce que, bien que les Terre-platistes aient fait du bruit au cours des dernières années, il est parfois difficile de distinguer les véritables platistes des nombreux trolls qui s’amusent à les encourager pour rire.)
Dans l’écosystème social d’aujourd’hui, les platistes forment une communauté marginale, dont les convictions paraissent loufoques pour la majorité des gens. Cela dit, à ma connaissance, il n’existe pas de mouvement fort qui vise à les exclure de l’espace public, les censurer ou les annuler. Les Terre-platistes ont un site web et une page Facebook qui attire quelques curieux et quelques détracteurs. En règle générale, malgré l’incrédulité qu’ils suscitent, les platistes bénéficient de la tolérance du public.
Cette tolérance s’explique probablement par le fait que le platisme ne convainc presque personne, et que les convictions de ceux qui croient que la Terre est ronde sont à ce point solides, démontrées et logiques qu’aucune tirade platiste ne parvient à ébranler leur certitude. Autrement dit, c’est la confiance tranquille dans ses convictions qui permet de tolérer sans difficulté le discours étrange de quelques excentriques.
Imaginez maintenant un monde dans lequel les Terre-platistes se seraient organisés pour prendre le contrôle des institutions politiques, sociales et médiatiques, et où ils auraient réussi à imposer le dogme platiste. Leurs thèses seraient alors enseignées à l’école, deviendraient le narratif officiel dans les médias et les citoyens ou leaders d’opinion qui remettraient en question l’idée que la Terre est plate seraient censurés, exclus, ou victimes de représailles.
Dans un tel univers, où la liberté d’expression serait sévèrement contrôlée et où certaines idées seraient proscrites, il y a fort à parier que plusieurs en viendraient rapidement à répéter le discours officiel — du moins en public — afin d’éviter des conséquences fâcheuses.
En surface, on pourrait ainsi croire que le Terre-platisme s’est imposé, que cette « vérité » est acceptée par tous, et qu’il n’y a plus lieu de débattre d’une réalité aussi clairement établie.
Le problème avec ce scénario (pour les platistes), c’est que le jour où leur capacité à étouffer la dissidence s’effriterait – le jour où les langues se délieraient et où la liberté de parole ressusciterait – le platisme s’effondrerait rapidement, confronté à ses propres absurdités.
Le phénomène rappelle les Habits neufs de l’Empereur: quand la vérité perce et expose le mensonge, l’écroulement est soudain et total. Rien n’est plus précaire que les convictions imposées, qui n’ont pas été forgées par un processus délibératif où les hypothèses et les arguments s’affrontent et où la vérité triomphe par la persuasion. La censure fragilise les idées; c’est le débat qui les rend résistantes.
La tentation de refuser le débat
Ces réflexions me trottent dans la tête depuis quelques semaines, notamment en observant ce qui se passe aux États-Unis. Dans le New York Times, une chronique récente de Ross Douthat reprochait aux élites progressistes d’Amérique et d’Europe d’avoir cherché à « tenir à distance les élans démocratiques » via divers mécanismes de censure institutionnelle plus ou moins subtils.
Au même moment, comme pour illustrer le phénomène, on pouvait lire au Québec quelques plaidoyers pour la limitation des débats, la proscription de certains discours, ou le refus de discuter avec ceux dont les idées sont jugées incompatibles avec l’ordre qu’on cherche à protéger.
Cette censure prend plusieurs formes. On cherchera par exemple à assimiler certaines opinions ou certaines paroles à de la violence — qu’il faut évidemment interdire. Dans d’autres cas, on invoquera un argument d’autorité pour expliquer que seuls les experts reconnus — c’est-à-dire ceux qui pensent comme nous — devraient être publiés et écoutés. On évoquera aussi, comme dans l’hypothèse d’une dictature Terre-platiste, que certains débats sont clos, que certaines questions ont été tranchées, et qu’il n’y a pas lieu de les rouvrir. D’autres enfin invoqueront le paradoxe de la tolérance pour expliquer que certaines idées intolérantes ne sauraient être tolérées — l’intolérance étant souvent assimilée aux idées contraires aux nôtres.
Ces tactiques me laissent profondément dubitatif.
D’abord parce qu’elles me paraissent peu convaincantes au niveau du principe. Hormis quelques exceptions bien établies — menaces de mort, diffamation, fraude, incitation directe à la (vraie) violence — la liberté d’expression protège… la liberté d’expression. C’est-à-dire la possibilité pour quiconque d’exprimer ses idées sans contrainte – et en particulier ses idées sociopolitiques – et d’en débattre librement. Au risque de répéter une évidence, la liberté d’expression vise avant tout les idées qu’on réprouve — et à plus forte raison celles qu’on abhorre viscéralement. C’est là le véritable test de l’engagement à défendre ce droit fondamental, peut-être le plus important de tous.
À partir du moment où l’on subordonne la liberté d’expression à des valeurs jugées supérieures — intérêt national, conformité politique, non-discrimination, bienveillance, respect ou autre — on entrave nécessairement la possibilité de s’exprimer librement. C’est une position qu’on peut légitimement défendre – vous avez le droit de plaider pour une liberté d’expression restreinte, qui exclut le droit de choquer, de contredire l’opinion majoritaire ou de remettre en question certaines normes établies – mais encore faut-il l’assumer clairement plutôt que de prétendre que ces contraintes et limites n’en sont pas.
Au-delà du principe, on peut aussi douter de l’efficacité de ces tactiques en pratique, notamment pour trois raisons.
Premièrement, parce qu’elles semblent reposer sur l’idée qu’on puisse encore contrôler la diffusion du contenu — comme à l’époque où les médias traditionnels faisaient office de gatekeepers — alors que la conversation publique s’est aujourd’hui déplacée vers les plateformes numériques, précisément parce qu’elles offrent plus de liberté, à plus de gens. Or, même si on jugeait souhaitable de réglementer la parole en ligne, ces plateformes et médias sociaux échappent largement à la capacité de contrôle des États.
Deuxièmement, parce que nonobstant les motivations de ceux qui refusent de discuter, de débattre ou d’accepter la diffusion de certaines idées, le public perçoit invariablement cette attitude comme une posture de faiblesse intellectuelle – l’inverse exact des globistes qui tolèrent sans problème (voire qui encouragent) les platistes à diffuser leurs idées, tant ils sont confiants dans la force de leurs arguments. Lorsqu’un discours s’impose non pas par la force de ses arguments mais parce qu’on interdit la dissidence, les bases du « consensus social » se fragilisent inévitablement.
Finalement, l’histoire récente suggère que la répression du discours a plutôt un effet boomerang. Il n’y a qu’à penser à la progression des partis populistes de droite en Europe au cours des dernières décennies pour constater que la stratégie du tabou, le fameux « cordon sanitaire », a lamentablement échoué. Au contraire, le refus d’écouter ou de débattre avec ces gens-là semble avoir nourri un ressac qui menace aujourd’hui de tout balayer sur son passage. Comme le disait Gladden Pappin, président de l’Institut hongrois des affaires étrangères et intellectuel américain Pro-Trump, dans une entrevue récente: « Le sentiment qu’aucun changement politique n’est possible [parce que notre discours est exclus des institutions publiques et médiatiques] est la plus grande source de radicalisation, des deux côtés. »
Répliquer à la répression
Plusieurs s’empresseront de répliquer qu’à notre époque, le plus grand adversaire de la liberté d’expression n’est nul autre que Donald Trump — l’homme qui, ironiquement, s’est fait élire sur la promesse de délivrer les États-Unis de la censure woke et de libérer la parole des Américains. Il en a d’ailleurs fait l’un de ses premiers décrets. La supercherie est assez évidente quand on sait à quel point le président Trump ne tolère aucune critique et cherche depuis toujours à faire taire, voire à faire emprisonner, ses opposants.
Il est tout à fait juste de reconnaître que la virulence et la violence de la répression trumpienne dépassent régulièrement le contrôle du discours jadis exercé par les Démocrates.
Pour les fins de ce billet, toutefois, la question n’est pas de savoir qui a commencé, ni de comparer la gravité des tactiques déployées par chaque camp. Pour le camp progressiste, l’enjeu politique de l’heure consiste plutôt à déterminer quel discours tenir face à une administration conservatrice autoritaire qui a choisi de censurer à son tour les idées qu’elle n’aime pas.
Le moment présente un dilemme fondamental. Faut-il se faire les défenseurs d’une liberté d’expression réelle, qui protège le discours politique et la dissidence sous toutes ses formes – même celles qui nous révulsent – et qui oppose à la censure trumpienne une vision forte et transpartisane de la liberté de parole ? Ou faut-il plutôt redoubler d’ardeur dans la volonté d’exclure certains discours, de limiter le débat et de mettre au ban certaines idées jugées irrecevables?
La première option – la seule valable à mon avis – implique deux choses qui pourront être difficiles à accepter pour certains progressistes.
D’abord, reconnaître que certaines idées qu’on a voulu ériger en dogmes inattaquables ou en vérités scientifiques au cours des dernières années ne sont, en fait, que des thèses discutables comme n’importe quelle autre, qu’on ne peut pas imposer et soustraire au débat public, et qui doivent plutôt faire l’objet d’échanges ouverts, vigoureux et persuasifs. Deuxièmement, la décision de défendre une vision forte de la liberté d’expression implique qu’on abandonne certaines notions – souvent qualifiées de lutte à la désinformation ou à la haine – commodément récupérées à des fins partisanes pour étouffer la critique et censurer les discours qu’on réprouve.
Cette posture n’implique pas que toutes les opinions se valent, bien sûr. Pour citer un billet précédent, « les thèses et les analyses qui font appel à des connaissances approfondies et diversifiées, qui s’ancrent de bonne foi dans le réel, qui reconnaissent leurs limites, qui s’exposent au principe de réfutabilité, qui font les nuances qui s’imposent, qui présentent adéquatement les contre-arguments, qui déploient des méthodologies transparentes et rigoureuses, et qui adoptent une posture de recherche authentique de la vérité – peu importe où elle mène – seront plus crédibles et auront davantage de valeur que les autres ».
La défense authentique de la liberté d’expression n’implique pas non plus qu’on écarte les exceptions importantes, et bien établies, qui existent déjà : fraude, diffamation, menace, invasion de la vie privée, etc. C’est plutôt un test de cohérence et d’intégrité : vous ne pouvez pas refuser à vos adversaires des libertés que vous réclamez pour vous-même, sous peine de vous discréditer. L’essayiste américain Freddie deBoer a récemment synthétisé ce risque, dans la foulée des menaces visant l’animateur Jimmy Kimmel:
« La gauche progressiste de ce pays a créé, au cours de la dernière décennie, un climat de censure qui a contribué à éroder notre attachement à l’idéal essentiel de la liberté d’expression. (…) Beaucoup de ceux qui s’indignent aujourd’hui de la censure de Kimmel par Trump ont, pendant des années, applaudi la mise au ban et la suppression des voix qu’ils n’aimaient pas, au nom de la pureté politique. (…) Des normes comme la liberté d’expression — car la liberté d’expression est une norme sociale autant, sinon plus, qu’un droit juridique — se maintiennent par la constance de leur mise en œuvre et s’affaiblissent lorsqu’elles sont appliquées de manière incohérente. Les progressistes qui ont rejeté la liberté d’expression comme concept réactionnaire se retrouvent désormais, comme tous les censeurs insignifiants finissent par l’être, du mauvais côté des codes de discours. Leur disposition passée à abandonner des principes fondamentaux pour préserver leur statut au sein du groupe rend leur indignation actuelle hypocrite et partisane. »
L’autre option politique — la posture d’une liberté d’expression tronquée, qui encadre le débat, filtre les perspectives et exclut certains propos – m’apparaît stratégiquement suicidaire tant elle ouvre la porte et déroule le tapis rouge à quiconque voudra invoquer les mêmes justifications pour faire taire les voix progressistes. (Aux États-Unis, les Républicains ne se sont pas gênés pour invoquer la haine, la violence verbale et la désinformation pour justifier leurs attaques contre les critiques de Charlie Kirk, les groupes anti-fascistes, les militants trans, etc.)
Ceux qui prônent la censure du débat public semblent ignorer la symétrie des choses et le fait que les contraintes qu’ils évoquent aujourd’hui se retourneront immanquablement contre eux demain, quand ils n’auront plus le pouvoir de contrôler la parole. À bien des égards et à bien des endroits, c’est déjà le cas. C’est d’ailleurs probablement pourquoi douze organisations de la société civile canadienne ont exhorté Ottawa, en 2023, à éviter toute nouvelle restriction à la liberté d’expression « au-delà de ce qui existe déjà dans la loi et le Code criminel » — de peur d’un effet glaçant sur la participation publique en ligne. Voilà une action clairvoyante.
Entre des partis populistes qui assument la répression et les militants progressistes qui promeuvent leurs propres formes de censure, ce sont assurément les seconds qui ont le plus à perdre. La stratégie du tabou — fondée sur la limitation des débats et l’interdiction de certaines idées — m’apparaît en effet aussi fragile que les dogmes platistes : il suffit que la parole se libère pour que tout s’écroule.
Jérôme Lussier s’intéresse aux enjeux sociaux, politiques et économiques. Juriste, journaliste et idéaliste, il a tenu un blogue au VOIR et à L'Actualité et a occupé divers postes en stratégie et en politiques publiques, incluant à l'Assemblée nationale du Québec, à la CDPQ et au Sénat du Canada.
11 Commentaires
Avant de commenter ou de participer à la discussion, assurez-vous d'avoir lu et compris ces règles simples
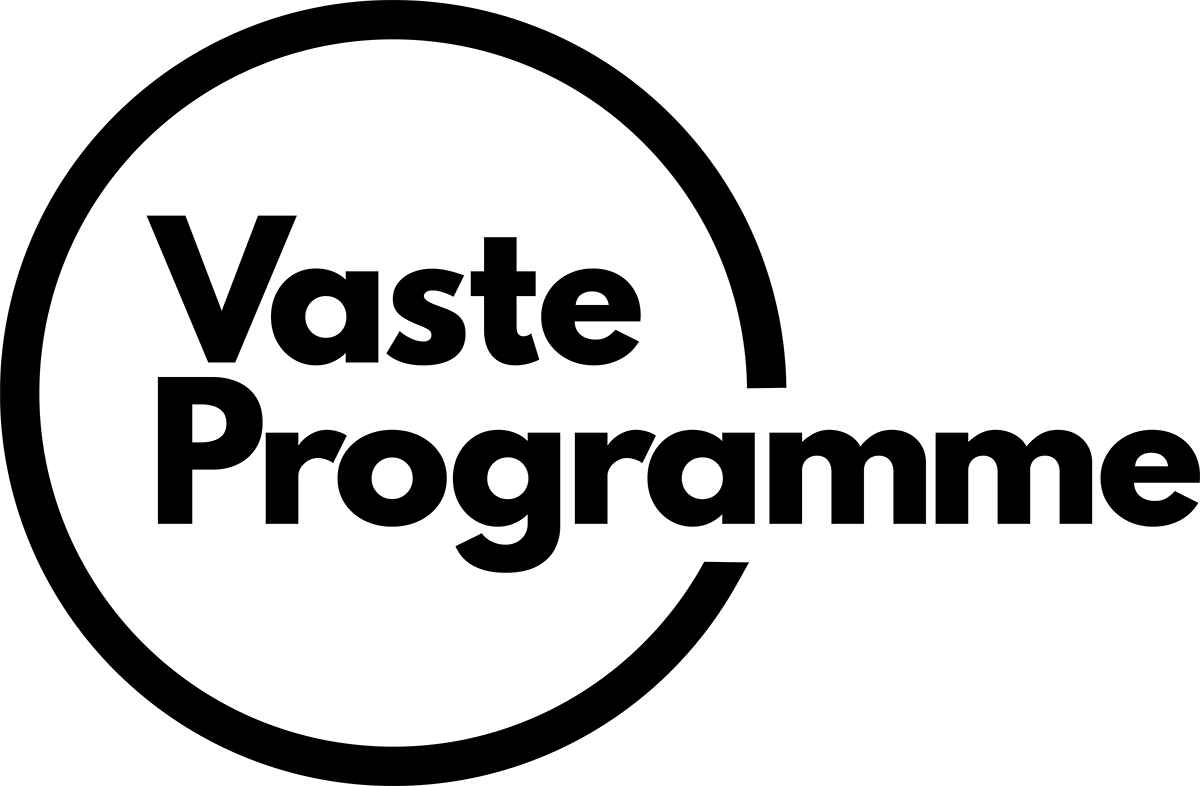
Jérôme Lussier dit : «Pour les fins de ce billet, toutefois, la question n’est pas de savoir qui a commencé, ni de comparer la gravité des tactiques déployées par chaque camp.» Quelles sont les fins de ce billet, alors? La question éludée m’apparaît pourtant fondamentale, surtout pour des personnes qui ont associé wokisme et censure pendant 5 ans. Mais l’auteur choisit de l’éviter. Comme le dit si bien l’auteur, la « stratégie du tabou» révèle la fragilité de son argument.
Votre commentaire aurait plus de poids et de pertinence si vous n’aviez pas volontairement éludé la phrase qui suit celle que vous citez: « Pour le camp progressiste, l’enjeu politique de l’heure consiste plutôt à déterminer quel discours tenir face à une administration conservatrice autoritaire qui a choisi de censurer à son tour les idées qu’elle n’aime pas. » Relisez-la bien et vous trouverez peut-être la réponse à votre question concernant « les fins de ce billet ».
Ma question était plutôt rhétorique. Ce que je veux dire, c’est que tout le texte repose sur une prémisse extrêmement fragile (c’est-à-dire un amalgame entre la censure fasciste et le militantisme woke) que vous choisissez de glisser sous le tapis en une phrase. La fausse équivalence qui sous-tend tout votre argumentaire est le tabou fragile de votre article.
Pour prendre un exemple concret, il y a des différences fondamentales entre un chroniqueur blâmé pour avoir dit trop de fois le mot en N dans une émission de radio publique de retour à la maison, et Mario Guevara, journaliste emprisonné en solitaire pendant 100 jours puis déporté dans la dictature salvadorienne pour avoir couvert des manifestations contre le président américain.
Le billet ne repose pas sur une comparaison entre la censure woke et la censure trumpienne. Au contraire, j’indique spécifiquement, dans la phrase que vous citiez, que ce n’est pas le but de l’exercice, qui visait plutôt à poser une question stratégique pour le camp progressiste. Je constate que celle-ci ne vous intéresse pas; c’est votre choix. Par ailleurs, si votre premier commentaire éludait sciemment la phrase qui suit celle que vous citiez, il semble que le second omet commodément celle qui précède. Je la recite au cas où vous l’auriez manquée: « Il est tout à fait juste de reconnaître que la virulence et la violence de la répression trumpienne dépassent régulièrement le contrôle du discours jadis exercé par les Démocrates. »
Si la question ne m’intéressait pas, je ne prendrais pas le temps de commenter votre texte. Merci de ne pas me présumer de mes intérêts. Bien sûr que cette question stratégique est importante, encore faut-il qu’elle s’appuie sur les bons diagnostics, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans les deux passages de votre texte que vous avez cité en commentaire, on retrouve la fausse équivalence que vous vous défendez d’entretenir: 1. « face à une administration conservatrice autoritaire qui a choisi de censurer à son tour les idées qu’elle n’aime pas ». « À son tour » suggère clairement qu’il y a alternance dans la censure. 2. « la virulence et la violence de la répression trumpienne dépassent régulièrement le contrôle du discours jadis exercé par les Démocrates. » Placer ensemble « la répression trumpienne » et « le contrôle du discours jadis exercé par les Démocrates », pour ensuite constater une différence de degré, c’est exactement ce qu’est une comparaison (Larousse: Action de comparer, de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leurs ressemblances ou leurs différences). Or, vous comparez deux choses qui sont de *nature* différente.
Puisqu’on parle ici d’une affaire qui me concerne, je me permets d’intervenir.
Lorsque monsieur de Grosbois mentionne l’histoire d’un “chroniqueur blâmé pour avoir dit trop de fois le mot en N dans une émission de radio publique de retour à la maison”, il reprend un récit erroné et répété de plusieurs manières depuis des mois dans certains cercles de discussions pour des raisons qui m’échappent. La chose m’étonne encore plus venant d’intervenants qui se présentent comme analystes des médias.
Il se trouve que ce chroniqueur, c’est moi.
D’abord, je précise que le CRTC ne blâme pas les chroniqueurs. C’est un tribunal administratif qui rend des décisions qui concernent les diffuseurs. Il s’agit de la SRC dans le cas qui nous occupe. C’est un détail qui a une certaine importance.
Quoi qu’il en soit, il est faux de dire que ce qui a été considéré comme une faute, dans cette affaire, était “d’avoir dit trop de fois le mot en N”. Je ne sais qui a inventé cette fadaise dont on semble se contenter un peu trop souvent à mon goût.
Ce qui a été reproché à la SRC, c’est de ne pas avoir tenu compte d’un “contexte social” en diffusant les propos qui faisaient l’objet de la plainte.
Il suffit de lire la décision pour s’en rendre compte. Le justificatif du CRTC est justement sous-titré “contexte social”.
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-175.htm
J’attire l’attention sur ce passage: “Bien que le « mot en n » soit un terme discriminatoire à proscrire pour désigner les personnes noires, le Conseil reconnaît que le mot n’a pas été utilisé de manière discriminatoire dans le cadre de la chronique, mais plutôt pour citer le titre d’un ouvrage qui était au cœur d’un enjeu d’actualité. Le Conseil note toutefois le contexte social actuel en lien avec les questions raciales et reconnaît que les radiodiffuseurs doivent faire preuve d’une grande vigilance lorsqu’il est question de propos potentiellement offensants.”
Voilà donc le cœur de l’affaire. Il n’est pas inintéressant de s’y attarder.
Nous sommes donc devant un tribunal qui, d’une main, reconnaît qu’aucun propos discriminatoire n’a été tenu – une notion tout à fait reconnue en droit et balisée par les lois – mais qui juge qu’il y a quand même lieu de sévir en référant à un “contexte social” – une notion qui n’a aucune assise en droit et qu’on invoque au gré des humeurs au nom de certaines valeurs hautement arbitraires.
Considérons donc ce constat pour ce qu’il est: un tribunal peut faire fi du droit et interdire certaines pratiques en invoquant des valeurs qui ne relèvent pas du droit.
La question générale qui se dégage alors est la suivante: qu’est-ce qui empêche une autre instance, dans un autre contexte et selon ses préférences politiques, d’appliquer ce même principe? Si vous acceptez l’idée qu’on puisse inventer, nonobstant toutes normes de droit, des fautes qui varient selon les appréciations des contextes sociaux, vous devrez bien vous confronter un jour ou l’autre à un protagoniste qui s’oppose à vous en usant du même stratagème.
Il y a là, bien évidemment, une base comparative permettant d’aborder plusieurs phénomènes de censure et, plus généralement, des désirs d’interdiction et de sanction. Bien évidemment, encore, cet exercice comparatif ne mènera pas nécessairement à une conclusion d’équivalence. Il est bien possible que ce protagoniste soit une brute qui déploie des moyens autrement plus inquiétants avec des conséquences plus graves. Chaque jour, ces temps-ci, nous en offre de multiples illustrations.
Mais un fait demeure: une fois que l’idée qu’on puisse mettre de côté le droit au nom de valeurs qu’on préfère est semée, toutes sortes d’injustices, des plus anodines aux plus odieuses, peuvent germer.
Pour la petite histoire, c’est la raison pour laquelle la plainte concernant la diffusion du “mot en N” a été retournée au CRTC qui doit la réévaluer en tenant compte non pas de vagues critères inconnus de tous, mais bien de la liberté d’expression, qui est justement, un principe établi en droit. On attend depuis mai 2023 cette nouvelle décision. On verra… Mais le moins qu’on puisse dire, c’est que ce tribunal n’a pas l’air pressé.
Je savais bien que vous étiez le chroniqueur en question et je n’ai pas douté une seconde que vous ne rateriez sous aucun prétexte l’occasion d’amener votre perspective sur l’affaire vous concernant. Sur le fond, par ailleurs, ça ne change pas grand chose à mon propos, à savoir qu’il n’y a aucune commune mesure ni relation de continuité entre 1. demander à un radiodiffuseur public de fournir des excuses et de revoir ses pratiques concernant l’usage de mots offensants et 2. emprisonner pendant 100 jours puis déporter un journaliste parce qu’il couvre des manifestations en opposition au Président du pays. Laisser entendre quelque chose d’aussi extraordinaire demande une démonstration extraordinaire, comme le veut le bon vieux rasoir d’Ockham. Le texte de Jérôme Lussier écarte cette démonstration en une phrase, ce qui affaiblit irrémédiablement son propos.
Mais je me répète, alors ce sera mon dernier commentaire, bonne journée à vous deux.
On peut, bien évidemment, considérer que comprendre et rapporter de manière juste les motifs d’une décision d’un tribunal administratif, ce n’est qu’une simple question de « perspective ».
C’est un pari méthodologique qui me semble audacieux et que je n’oserais pas personnellement faire, mais bon, là comme ailleurs, je suis pour la liberté d’expression.
Si en partant, vous ne voulez pas « comparer la gravité des tactiques déployées par chaque camp », ça devient une discussion purement abstraite sur la liberté d’expression, qui exclut toute dynamique de pouvoir. En excluant le pouvoir, en se situant sur le pur plan des idées, on est tous automatiquement en faveur de la pleine liberté d’expression, surtout comme intellectuels (j’en fais partie) pour qui la libre expression est immédiatement essentielle. Toute limitation revient soit à un exercice de pouvoir, soit à une protection contre les pouvoirs. C’est là que les choses deviennent intéressantes, et qu’on peut avoir un réel débat.
Lea auteurs nommés dans le texte (Pappin, deBoer) ne sont pas de purs entités abstraites, ce sont des gens qui ont une idéologie à vendre, et leur appel à la pleine liberté fait partie de ce programme.
Tout débat sur la liberté d’expression est nécessairement aussi un débat sur le pouvoir, qu’on l’admette ou pas.
Il me semble que votre commentaire me reproche en quelque sorte d’avoir écrit sur le mauvais sujet, ou suivant une perspective que vous n’aimez pas. C’est une critique qui me paraît plutôt étrange. La question que pose le billet est la suivante: « Pour le camp progressiste, l’enjeu politique de l’heure consiste à déterminer quel discours tenir face à une administration conservatrice autoritaire qui a choisi de censurer à son tour les idées qu’elle n’aime pas. Le moment présente un dilemme fondamental. Faut-il se faire les défenseurs d’une liberté d’expression réelle, qui protège le discours politique et la dissidence sous toutes ses formes – même celles qui nous révulsent – et qui oppose à la censure trumpienne une vision forte et transpartisane de la liberté de parole ? Ou faut-il plutôt redoubler d’ardeur dans la volonté d’exclure certains discours, de limiter le débat et de mettre au ban certaines idées jugées irrecevables? »
Avez-vous quelque chose à dire sur ce choix? Ou est-ce que votre commentaire se résume à me reprocher de poser la question?
Vous endossez la première option, j’ai dit que selon moi c’est trop abstrait comme débat. Moi j’endosse plutôt la seconde, et j’ai dit pourquoi.