Séparés mais égaux – École à trois vitesse et ségrégation
L’accès à des services essentiels, l’éducation et les soins de santé, varient selon la capacité de payer. Pour les mieux nantis, ça va plus vite. Les autres doivent prendre leur mal en patience. - Un extrait de l'essai Séparés mais égaux de Christophe Allaire Sévigny publié chez LUX.

Imaginez la scène. Dans une classe d’une école secondaire, des jeunes de 13-14 ans s’entassent avec précipitation devant de grandes fenêtres pour regarder la cour de l’établissement. Une étrange excitation les anime. Dehors, des jeunes du même âge s’élancent dans un parcours d’hébertisme tout neuf. Ils s’exercent sous la supervision d’un enseignant. Certains réussissent plutôt bien les défis que pose la structure, d’autres s’accrochent de peine et de misère aux cordages ou chutent carrément en bas de la plateforme, se retrouvant suspendus dans le vide, retenus par leur harnais de sécurité. Ils rigolent, se moquent de leurs maladresses, applaudissent leurs exploits – en toute insouciance, comme cela doit l’être à cet âge. À l’intérieur, les jeunes sont moins enthousiastes. Ils sont amusés par le spectacle qu’ils observent à travers la fenêtre, mais ce divertissement leur laisse un arrière-goût amer.
Eux n’auront jamais accès à ces installations. Ils ne goûteront pas non plus aux joies des sorties en vélo de montagne ou des journées de ski alpin qu’offre leur école, comme ils n’auront pas l’honneur de jouer pour son équipe de hockey. Tous ces sports leur sont inaccessibles. Pourquoi ? Parce qu’eux sont des élèves du programme « régulier » et que toutes ces activités sont réservées aux élèves des programmes de « santé globale » et de « sport-études ». Pour y être admis, il faut avoir maintenu une moyenne générale supérieure à 70 % au primaire et, surtout, débourser une somme considérable. Entre 750 et 5 000 dollars par année, selon le programme. Ces élèves massés au bord de la fenêtre, les yeux rivés sur l’épatante structure d’hébertisme, proviennent pour la plupart de familles aux revenus trop modestes pour se permettre une telle dépense. Ces jeunes garçons et filles n’ont pas tiré le bon numéro à la loterie de la vie. Une leçon que l’école leur enseigne à la dure.
Cette scène n’est pas tirée d’un film. Elle s’est déroulée récemment dans une école du Québec. C’est un enseignant, Daniel, qui me l’a racontée. S’il tenait à me partager cette « anecdote », c’était pour témoigner de l’« aliénation » (ce sont ses mots) que vivent ses élèves. Aliénation. Le mot est-il exagéré ? Daniel croit que non. Il s’agit bien de ça : être dépossédé de ce qui nous revient de droit. Comment ces jeunes, qui regardent leurs camarades jouir d’équipements neufs en les sachant hors de portée, ne peuvent-ils se sentir considérés comme des élèves de seconde zone ? Comment ne peuvent-ils avoir l’impression qu’on les dépouille de leur dignité ? Comment un enseignant qui respecte ses élèves peut-il tolérer que l’école les humilie en douce ?
Daniel connaît bien son école. Il y enseigne depuis près de trente ans et y a étudié lorsqu’il était adolescent. Il y a même fait son stage lors de ses études universitaires. « Ce n’est pas super original… », confesse-t-il en se remémorant son parcours. Il se souvient qu’à l’époque où il la fréquentait, dans les années 1980, sa polyvalente n’était pas l’endroit segmenté, quadrillé, fragmenté qu’elle est devenue aujourd’hui. On était riche, on était pauvre, on était bon ou médiocre, on rencontrait des difficultés, mais tous ramaient dans la même barque. Il y régnait une grande mixité sociale. Malgré l’existence de certains parcours différenciés « allégés », « enrichis » et « moyens » dans les matières de base (français, anglais, mathématiques), il n’y avait pas de groupes fermés et exclusifs. Dans la majorité des cours, tous les élèves se fréquentaient. Aujourd’hui, les élèves du « régulier » et ceux de « sport-études » ne se côtoient pas. Ils ne sont pas dans les mêmes classes. Ils sont séparés. En tant que jeunes Québécois, la loi les oblige tous à fréquenter l’école jusqu’à 16 ans, mais ils le font en empruntant des parcours rigoureusement distincts.
Daniel a vu son école se transformer en une sorte de Titanic où chaque élève navigue dans la classe propre à son statut social. Ses élèves voyagent en fond de cale et cela les contrarie. Daniel partage leurs frustrations. Il n’aime pas que l’école présente à cette jeunesse l’égalité des chances comme une mauvaise blague. Ce n’est pas pour leur transmettre cette honte qu’il a choisi ce métier.
Des histoires semblables à celle que relate Daniel, j’en ai entendu plusieurs au sujet d’écoles établies dans des villes très différentes. Ce n’est guère étonnant. Notre système d’éducation, en effet, est devenu un centre de tri social départageant les « bons » des « mauvais » éléments. Les élèves québécois du secondaire sont ainsi séparés dans trois grandes filières : 60 % fréquentent l’école publique ordinaire, 21 % l’école privée et 19 % les programmes pédagogiques particuliers (PPP) de l’école publique [1]. C’est ce phénomène qu’on appelle depuis quelques années déjà « l’école à trois vitesses ».
L’expression « école à trois vitesses » est d’usage très courant aujourd’hui. Elle fait image, sans doute parce qu’elle évoque le concept du système de santé « à deux vitesses ». Ces deux formules rappellent que l’accès à des services essentiels, l’éducation et les soins de santé, varient selon la capacité de payer. Pour les mieux nantis, ça va plus vite. Les autres doivent prendre leur mal en patience.
Mais lorsqu’on y réfléchit mieux, on doit se rendre à l’évidence : dans le cas du système d’éducation, la notion de vitesse n’a guère de sens. Le fait d’avoir des moyens financiers n’accélère pas le parcours éducatif. L’année scolaire, peu importe le type d’école fréquentée, commence à la fin des vacances estivales, se termine autour du solstice d’été, contient 180 jours d’école et 20 journées pédagogiques. L’image de la vitesse n’est pas pertinente ici. Sauf si on veut laisser entendre qu’il y a une école pour les élèves qui sont « vite » – lire : brillants – et une autre pour les moins futés. Il s’agirait alors simplement d’ajuster l’offre scolaire aux besoins et à la demande.
Aurélie Diep, étudiante au bac en enseignement préscolaire et primaire, et présidente de la Commission de la relève de la Coalition Avenir Québec (CAQ), a défendu cette dernière interprétation dans un discours prononcé le 7 septembre 2024 lors d’un colloque intitulé « L’école que l’on aime » :
Ça m’énerve un peu quand j’entends les politiciens dénoncer l’école à trois vitesses, comme si c’était souhaitable ou possible d’imposer la même vitesse à tous les élèves. Les plus belles réussites de notre système d’éducation dans les dernières années, c’est grâce à la diversité des choix pour les élèves et les parents. Le choix d’aller au public ou d’aller au privé, le choix d’entrer dans un programme particulier qui correspond à ses passions. Quand je vois ça, je me dis qu’il nous faut une école à 10, 15 ou même 100 vitesses ! [applaudissements] Je sais que notre ministre de l’Éducation, M. Drainville, partage notre vision. […] L’école qu’on aime, elle fait place à tous les talents, à toutes les passions, à toutes les ambitions différentes au lieu de vouloir ramener tout le monde à la même vitesse. Elle accompagne les jeunes à la vitesse qui leur convient [2]
La tirade est bien sentie. Une école à 100 vitesses ! Le ministre Drainville, s’émeut la jeune caquiste, veut accompagner les jeunes au rythme qui leur convient. Il défend une offre scolaire abondante qui puisse satisfaire toutes les passions – celles des esprits pressés, celles des personnalités patientes, celles des égarés comme des déterminés. Qui s’opposerait à l’utopie d’une éducation taillée à la mesure de chacun ? Mais encore faut-il que l’élève ait les moyens de se l’offrir. Car l’école à trois vitesses a aussi des coûts différenciés. Le client est roi… tant qu’il paye rubis sur l’ongle. Aurélie Diep ne dit rien de ceux et celles qui ne peuvent pas payer. On peut imaginer que ces élèves ont pour passion d’emprunter une voie de garage où ils n’avanceront pas tellement. De toute évidence, l’expression « école à trois vitesses » ne convient guère. Au mieux, elle ne veut rien dire – l’école commence et se termine à la même date pour tous. Au pire, elle ne fait que masquer la réalité qu’il faudrait mettre en lumière. Il serait bien temps de trouver une expression plus juste.
En repensant aux propos de Daniel, il m’a aussi semblé que son « anecdote » n’avait rien à voir avec la vitesse. On a plutôt affaire à un enjeu de séparation, de démarcation de l’espace, d’inégalité des vies. [3]
L’école de Daniel n’a pas un problème de vitesse, elle a un problème de division, d’exclusion et de mépris. Elle est une école ségréguée. Voilà la vérité embarrassante que Daniel pointe du doigt : l’école québécoise est un régime de ségrégation sociale.
C’est bien de cela qu’il s’agit : sé-gré-ga-tion, du latin segretatio, qui signifie « séparation imposée, de droit ou de fait, d’un groupe social d’avec les autres ». Sous le régime juridique de Jim Crow aux États-Unis, la ségrégation était raciale. La ségrégation scolaire québécoise, elle, ne se fonde pas sur l’héritage génétique, mais sur l’héritage social. La ligne de démarcation n’est pas déterminée par la couleur de la peau, mais par le capital économique et culturel de la famille. C’est une différence significative. Mais dans un cas comme dans l’autre, le hasard de la naissance impose un verdict social auquel on échappe difficilement.
Au Québec, la ségrégation scolaire n’est pas le fruit d’une politique officielle. Aucun parti politique n’a fait campagne en sa faveur, aucun éditorialiste, aucun pédagogue, pas une mère, pas un père n’a fait l’éloge de ses vertus. Pourtant, elle existe. En façade, dans les discours, dans les principes, tous les jeunes sont égaux et seul le mérite les distinguera. Dans la réalité, l’institution les aiguille dans des cheminements cloisonnés. Ils sont égaux, mais séparés. La ségrégation qui a cours aussi bien à l’intérieur de nos écoles qu’entre celles-ci est le résultat inavoué, et sans doute inavouable, d’un certain nombre de décisions et d’actions des acteurs du système d’éducation au courant des soixante-cinq dernières années. Des décisions qui ont entraîné, lentement mais sûrement, la fragmentation du système scolaire québécois au secondaire.
Le mot « ségrégation » est dur, j’en suis conscient. Il renvoie à des moments troubles de l’histoire de l’humanité. Mais à mes yeux, c’est le mot juste. Car ce qui se vit présentement dans les écoles du Québec constitue un moment sombre de notre histoire. Nous n’en avons simplement pas encore pris conscience collectivement.
._._._.
[1] Anne Plourde, « Où en est l’école à trois vitesses au Québec ? », Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), 19 octobre 2022.
[2] CAQ, « Discours de la présidente de la CRCAQ Aurélie Diep », YouTube, 12 septembre 2024.
[3] J’emprunte ici l’expression à Didier Fassin. Voir Didier Fassin, De l’inégalité des vies, Paris, Collège de France / Fayard, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », 2020, p. 80.

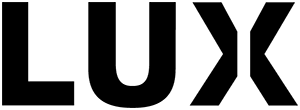
Avant de commenter ou de participer à la discussion, assurez-vous d'avoir lu et compris ces règles simples