Culture du bannissement: retour de balancier ou recherche du point d’équilibre?
Fondements et limites de la culture du bannissement

Les annulateurs renvoyés dos à dos
Toute tentative d’engager une réflexion critique sur la culture du bannissement (CDB) se heurte rapidement au mur des discours formatés et des justifications automatiques.
Et pourtant, les langues commencent à se délier et on ressent collectivement le besoin de plonger pour explorer en profondeur ce phénomène complexe, qui a pris des formes différentes à travers les époques et les civilisations, tantôt en se réclamant de la protection de l’ordre établi contre le désordre et la subversion, tantôt en prônant le recours à des méthodes subversives pour renverser ce même ordre (bannir pour briser un système, un cycle ou des mécanismes de reproduction de la violence et de la domination).
L’arrivée au pouvoir de Trump aux États-Unis a en quelque sorte libéré la parole de ceux et celles qui hésitaient à remettre en question cette pratique, par crainte de se faire accuser de pointer les néoprogressistes et d’épargner les néoconservateurs. En effet, en se contentant de dénoncer les dérives de la gauche radicale, plus audible et plus encline à bannir durant les dernières années (sur les campus ou la scène culturelle et artistique), les pourfendeurs les plus virulents de la CDB perdaient parfois de vue les formes plus subtiles et plus discrètes de censure pratiquées par leur propre camp idéologique.
La critique raisonnée de la CDB butait contre le climat ambiant : peu de place pour la nuance, prise en otage du débat public par les postures manichéennes, injonctions, campagnes de salissage et culpabilité par association.
Ajoutons à cela le brouillard conceptuel, la confusion des genres et des cas de figure.
On confond parfois censure et autocensure, censure militante et censure d’État.
On met sur le même plan le fait d’exercer librement son droit de critiquer une parole et le fait de s’arroger brutalement le pouvoir de bannir de l’espace public celui qui l’a prononcée.
On ne distingue pas toujours deux situations très différentes : une personne tombée en disgrâce après avoir été poursuivie, jugée, et reconnue coupable, d’une part, et d’autre part une personne bannie arbitrairement, balayée par une vague de dénonciations anonymes, qui ne connait pas vraiment les faits qui lui sont reprochés, n’a pas fait l’objet de plainte formelle, n’a pas eu la possibilité de se défendre et devra par conséquent vivre avec cette tache sans espoir d’être un jour blanchie ou réhabilitée.
Donald Trump et ses partisans ont souvent dénoncé la CDB comme une menace à la liberté d’expression, accusant la gauche de vouloir censurer les voix conservatrices.
Aussitôt élu, le président a déployé l’artillerie lourde de l’État pour réprimer ses adversaires personnels et politiques. Le cas de Jimmy Kimmel est particulièrement évident, de même que certaines déclarations à l’encontre de militants de gauche, dans la foulée de l’assassinat de Charlie Kirk.
Ces agissements sont contraires à toutes les normes démocratiques et constituent un précédent très dangereux, même si Trump allègue qu’il ne fait que répliquer à des tactiques déployées jadis contre lui par les démocrates.
La dérive autoritaire de Trump fait cependant office de contre miroir; elle interroge, bouscule la conception révolutionnaire de la CDB, et met en évidence l’impasse à laquelle cette pratique conduit. Une justice expéditive qui revêt les oripeaux de la justice corrective ou de la légitime défense, une spirale du ressentiment et de la revanche, qui nous pousse à retourner le sablier des violences (symboliques, institutionnelles ou identitaires) à notre avantage aussitôt qu’on est en position de pouvoir.
Il est toutefois important de préciser que les cas de bannissement les plus marquants des dernières années étaient le fait de groupes de pression et non d’une censure d’État : l’annulation des pièces Slav et Kanata, l’affaire du mot en N, les listes de présumés agresseurs sexuels diffusées sur les réseaux sociaux , l’affaire de la marionnette de Franck Sylvestre, l’affaire Jocelyne Robert, etc.
La distinction n’est pas anodine. Que des activistes utilisent des méthodes radicales pour court-circuiter les processus institutionnels dont ils se méfient, c’est de bonne guerre. La posture révolutionnaire ne croit pas à la politique des petits pas et considère qu’elle doit s’attaquer au système pour le renverser, quitte à faire des victimes collatérales.
En revanche, quand des dirigeants d’institutions plient devant la pression et incitent leur personnel à l’autocensure, au lieu d’appliquer rigoureusement leurs propres mécanismes de gestion des plaintes pour sanctionner les manquements, tout en protégeant les individus contre les déferlements hostiles, c’est un déficit de courage managérial, une capitulation, une compromission éthique, un arbitrage sacrificiel.
Un détour par la cour du roi
La CDB n’est pas une invention de l’extrême gauche : une évidence qu’il est utile de rappeler.
On se souvient du film de Patrice Leconte, Ridicule, sorti en 1996, une satire de la cour de Versailles à la veille de la Révolution française, qui expose les ressorts du pouvoir, de l’exclusion et de la violence symbolique à travers le prisme de l’esprit et du langage.
Lors d’un salon à Versailles, l’abbé de Vilecourt tente d’impressionner le roi et les courtisans en affirmant avoir démontré l’existence de Dieu. Le roi et le public semblent conquis, juste avant que l’abbé n’ajoute cette réplique fatale: « Mais… je pourrai démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. »
Censée illustrer sa virtuosité dialectique, la pirouette est reçue comme une provocation blasphématoire. Le roi, choqué, reste silencieux. Les courtisans s’indignent : « Quelle impiété ! Devant le roi ! »
L’abbé tombe aussitôt en disgrâce. La chute est brutale et sans appel.
Cette scène n’est pas sans rappeler les controverses récentes autour de propos jugés offensants alors qu’Ils n’avaient rien de condamnable dans le contexte où ils ont été prononcés (des titres de livres par exemple).
Ce n’est pas la véracité du propos qui compte, mais sa réception dans une dynamique de rapports de force (un régime autoritaire, des lobby puissants, un climat social propice au clientélisme et à l’opportunisme politique).
Un siècle plus tôt, en 1896, la pièce Ubu Roi d’Alfred Jarry mettait en scène une forme grotesque et absurde de pouvoir tyrannique, où le bannissement devient un outil central de domination, d’humiliation et de contrôle.
Dans un élan d’épuration radicale, Ubu fait exécuter ou chasser tous ceux qui pourraient contester son autorité, y compris ses anciens alliés.
L’exclusion devient un acte public, théâtralisé. Le langage d’Ubu sert à déshumaniser ses cibles (qu’on les décervelle!) comme le font aujourd’hui les campagnes d’avilissement en ligne.
Les justifications de la CDB
Dans cette section, je tente de reprendre les arguments invoqués par les tenants de la CDB, d’en expliciter les fondements et d’en exposer les limites.
J’examine ici la ligne argumentative du courant néoprogressiste, qui se réclame de la justice sociale et du droit à la différence. Les régimes autoritaires, quant à eux, ne n’embarrassent pas de justificatifs, l’arbitraire et l’abus de pouvoir faisant partie de leur ADN.
« Les dénonciations publiques sur les réseaux sociaux, anonymes ou non, avec ou sans preuves, accompagnées de pressions politiques pour bannir la personne dénoncée, sont des moyens légitimes de contourner les lenteurs et les dysfonctionnements du processus judiciaire. »
En effet, le système est imparfait et dysfonctionnel à bien des égards. Une personne nantie peut échapper à des plaintes fondées en usant de tous les recours possibles et en s’offrant les services d’un ténor du barreau capable de la faire innocenter en jouant sur un vice de procédure ou sur le doute raisonnable.
Une victime, déjà éprouvée par une injustice ou une agression, peut se laisser décourager par la lourdeur du processus et renoncer à obtenir justice. Sans compter la honte et la peur de faire face à une défense agressive, qui met à l’épreuve sa crédibilité et son intégrité morale.
Mais le temps judiciaire n’est pas le temps politique.
Le temps judiciaire permet de prendre du recul face aux émotions, aux pressions médiatiques ou politiques.
Il protège contre les jugements hâtifs, dictés par les passions collectives et la morale de l’heure.
Pour assurer le respect des droits de chacun, la vérité judiciaire ne peut être rendue dans la précipitation : elle ne se décrète pas, elle se construit .
Le système est imparfait mais perfectible.
On peut prévoir des parcours et dispositifs spécifiques, du personnel dédié à certains types de crimes (le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, le Tribunal des droits de la personne, etc. ), resserrer les délais, renforcer les mécanismes de protection de l’identité des victimes, sanctionner plus sévèrement les manœuvres dilatoires et les abus de procédures qui minent la confiance en la justice et prolongent les souffrances des plaignants.
Quant aux victimes qui souhaitent être reconnues dans leur souffrance et obtenir justice et réparation sans vivre le traumatisme d’un procès, et sans nécessairement que leur agresseur soit emprisonné, les voies de la justice réparatrice leur offrent des avenues intéressantes.
Bien entendu, on trouve toujours des cas extrêmes pour lesquels le bannissement est la seule forme possible de réparation, comme pour les pédophiles et les récidivistes qui n’éprouvent aucun remord et sont imperméables à la réhabilitation.
Du reste, la réhabilitation obéit à des règles et exige aussi du temps. Elle suppose un cheminement, une introspection, une sincérité dans les remords, une implication authentique pour retrouver sa place dans la communauté ou dans la vie publique, le cas échéant.
Prenons Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir qui a tué sa compagne Marie Trintignant en 2003 et dont la conjointe Krisztina Rády s’est suicidée en 2010. L’artiste déchu a tenté un retour progressif sur scène, deux ans après sa sortie de prison, en 2009, et ce n’est qu’en 2018 que sa carrière a pris fin sous la pression des groupes de défense des droits des victimes.
Le documentaire De rockstar à tueur, diffusé en 2025, revient sur ce féminicide traité comme un accident alors que l’autopsie était accablante (la victime a été sauvagement battue) et passe au crible les logiques d’emprise et de violence à l’origine du meurtre et du suicide de ses compagnes.
Une réévaluation sociétale de l’affaire, à l’ère post-Me Too, met de l’avant le concept de féminicide et dénonce la romantisation de la violence dans le traitement médiatique de ce meurtre qui n’avait rien d’accidentel. Un retour sur scène dans les circonstances devient hautement questionnable au plan de l’éthique, insoutenable pour les familles éprouvées et en contradiction avec les politiques actuelles de lutte contre les violences domestiques et sexuelles, qui ne relativisent plus les « crimes passionnels » ou encore les « crimes d’honneur ».
« Ce n’est pas vrai qu’on ne peut plus rien dire : ceux qui revendiquent leur liberté d’expression doivent accepter qu’on les critique et qu’on dénonce leur discours. »
C’est tout à fait juste. On ne peut réclamer la liberté pour soi et la censure pour les autres.
Toutefois, le bannissement n’est pas une simple critique, un droit de réplique ou une dénonciation.
Rétorquer publiquement à un contradicteur en lui opposant des contre arguments relève de la liberté d’expression. S’acharner sur lui dans les réseaux sociaux et l’exposer à la vindicte de nos alliés, déclarer coupables par association les personnes qui lui accordent la présomption d’innocence, multiplier les pétitions, harceler son employeur pour le faire congédier, exercer des pressions économiques en menaçant de se désabonner du journal qui l’emploie, de couper la subvention accordée à l’organisme qui l’invite ou qui collabore avec lui… C’est de l’intimidation. A fortiori quand les pressions se font en coulisses, sans que la personne visée ne soit mise au courant. L’employeur ou les collaborateurs ont alors tout le loisir de plier et de trouver un motif quelconque pour se débarrasser de la personne devenue encombrante, sans révéler les vraies raisons du lâchage en règle.
Ce genre de procédé ouvre la porte aux règlements de comptes et aux accusations mensongères, surtout quand les annulateurs opèrent dans l’ombre et en meute. Le groupe rend plus fort, mais la meute attise la cruauté.
Ces méthodes encouragent par ailleurs l’autocensure, car la liberté d’expression ne peut s’exercer dans de telles conditions.
« Le bannissement est l’arme des sans-voix, des exclus du système, des inaudibles et des invisibles ; les privilégiés n’ont pas besoin de bannir pour faire valoir leurs droits et pour exercer le pouvoir. »
Ce n’est pas aussi simple. Des lobby économiques, communautaires ou scientifiques se servent aussi de cette arme, même s’ils représentent les puissants ou qu’ils ont un pouvoir politique.
De plus, le bannissement est à la fois une manifestation de pouvoir et de contre-pouvoir. Quand on est capables de bannir, c’est qu’on a déjà un poids politique et médiatique assez lourd pour faire plier des institutions.
Les sans-voix, quant à eux, aspirent à se faire entendre, pas à faire taire leurs interlocuteurs.
Les vulnérables sont souvent plus pragmatiques et tellement moins exaltés que leurs porte-parole autoproclamés, aussi bien intentionnés soient-ils.
Quand on prend la peine de se décentrer et de se dégager des grilles d’analyse prêtes-à-porter, on réalise qu’il est plus sage de savoir bien écouter la parole des exclus, de s’assurer qu’elle trouve un espace et des moyens pour être recueillie, et de la laisser tracer son chemin en marchant à côté, sans accaparer le micro et sans imposer nos remèdes.
« La CDB est une forme de justice réparatrice, concurrente à la justice traditionnelle. »
La justice réparatrice est une justice alternative, pas un tribunal populaire ni une justice expéditive.
Elle a ses règles, son éthique, ses méthodes et ses principes, dont le bannissement ne fait pas partie.
Elle repose sur l’écoute, la responsabilisation et la réparation plutôt que sur la punition.
Elle place la victime au centre du dispositif afin de ne pas victimiser les coupables en faisant comme s’il s’agissait d’un rapport d’égal à égal; elle vise toutefois la prévention de la récidive, le soulagement des victimes et ultimement le renforcement du tissu social et le rétablissement des liens.
La philosophie de la justice réparatrice s’applique autant aux victimes individuelles, qui souhaitent guérir par les voies de la reconnaissance et de la réparation, qu’aux protagonistes de grands conflits internationaux comme les crimes de masse et les guerres civiles ayant divisé une même population qui aspire à panser les blessures avant de retrouver son unité (ex : le Rwanda),
Une autre variante de la justice réparatrice est la justice mémorielle, qui désigne l’ensemble des démarches juridiques, politiques et sociales visant à reconnaître officiellement des injustices passées, à réparer symboliquement ou financièrement les torts subis, et à préserver la mémoire collective. Elle s’inscrit souvent dans des contextes post-coloniaux, post-conflits ou de reconnaissance de violences historiques.
Cette forme de justice n’utilise pas des méthodes comme les listes de la honte ou les pressions pour bannir des individus. Elle rétablit les faits, désigne les bourreaux encore vivants et les livre à la justice, examine les torts, les violences systémiques et les logiques de domination, évalue leurs effets intergénérationnels, le cas échéant, et détermine les formes de réparation.
Il peut arriver, comme en Afrique du Sud, que la justice réparatrice accorde l’amnistie aux auteurs de crimes qui se sont dénoncés, à condition qu’ils disent toute la vérité et que leurs actes aient été politiquement motivés.
Un tel choix révèle les limites de la justice restaurative et laisse parfois un goût amer aux victimes, le sentiment que leur bourreau n’a pas payé sa dette, qu’il a bénéficié d’une amnistie en amont, sans assurance qu’il regrette vraiment ses crimes.
On peut comprendre, dans un tel cas, que des listes de tortionnaires dont les crimes sont avérés circulent, pour réclamer justice et dénoncer une amnistie hâtive.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE. Dans le deuxième volet de cet article, j’aborderai la notion de pardon, un concept qui est convoqué trop rapidement dans la conversation sur la CDB et que l’on confond encore trop souvent avec l’absolution ou la réhabilitation.
Rachida Azdouz est psychologue, autrice et chroniqueuse. Chercheure affiliée au LABRRI, son programme est modeste : résister aux injonctions, surveiller ses angles morts, s'attarder aux frontières et poursuivre sa quête.
14 Commentaires
Avant de commenter ou de participer à la discussion, assurez-vous d'avoir lu et compris ces règles simples
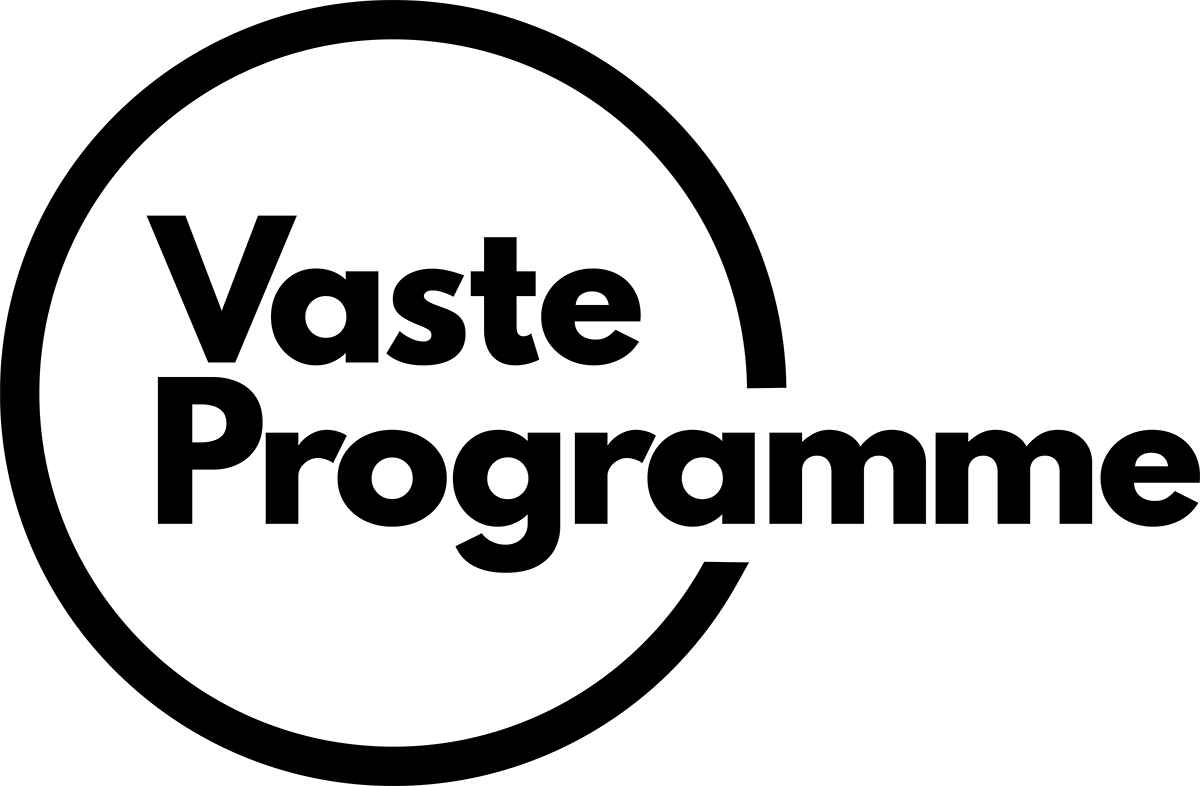
C’est un texte intéressant, mais ce n’était pas nécessaire d’inventer des phrases qu’un idéaltype woke est susceptible de prononcer. Il existe une littérature qui soutient ce genre de positions, avec des arguments et des développements qui ont fort probablement anticipé vos contre-arguments. Un véritable échange d’idées aurait été préférable.
Voilà qui fait sourire. Vous êtes le seul ici à enfermer ces quelques arguments au sein d’un « idéaltype woke ». Le monde est pourtant vaste, et parfois étonnant, hors de ces étiquettes auxquelles vous semblez tenir. Mais bon, ce n’est pas bien grave, ce sont des choses qui arrivent.
Je ne suis pas attaché à ce terme, on peut le changer; « la moyenne de la gauche diversitaire » est aussi bon. Mon point est qu’on avait ici une occasion de dialoguer avec les intellectuels de gauche qui maintiennent ce genre de thèses. Il n’était pas nécessaire d’imaginer ce que ceux-ci pensent.
Vous êtes bien rigolo monsieur Gagné,
En effet, on peut changer une étiquette pour une autre si vous le désirez. Ainsi va la vie. Choisissez-en trois autres si le coeur vous en dit. Ou vingt-six, pour ce que ça change. Un fait demeure: si votre désir était réellement de saisir les occasions de dialoguer avec des intellectuels d’un camp ou d’un autre, comprenez au moins que vous faites un peu rire. Vous l’aviez ici, cette occasion, et vous ne l’avez pas saisie. Comme je disais, ce n’est pas très grave, ce sont des choses qui arrivent. Ça vous donnera de la matière pour alimenter le persiflage quotidien sur Bluesky. On a les dialogues qu’on peut.
Au plaisir.
M. Jodoin, Mme Azdouz, il va tout de même falloir admettre que les risques de sophisme de l’homme de paille sont quand même assez grands lorsque vous inventez des citations. Ce que M. Gagné soulève c’est quand même la base de la base. On apprend à citer ses sources à l’école secondaire; Mme Azdouz est chercheure dans un labo de recherche. Si les auteurices qui écrivent dans votre magazine sont pas en mesure de fournir de véritables citations, ou d’indiquer d’où proviennent leurs paraphrases, leurs textes n’ont pas beaucoup plus d’intérêt que du chialage informel. On apprécierait un peu plus de rigueur, peut-être?
🙂 … Mais, monsieur ou madame Umzidiu… Il me semble tout à fait clair que les énoncés mis en exergue dans ce texte ne sont pas des citations, mais, tel qu’il est clairement mentionné, des éléments d’une ligne argumentative que l’auteure fait ressortir pour les mettre en évidence, comme il est tout à fait commun de le faire.
Après, vous pouvez bien évidemment considérer qu’un tel texte est sans intérêt. Ce sont des choses qui arrivent et je ne m’en formaliserai pas. Je ne suis pas d’accord avec vous et ainsi va la vie.
Bon dimanche.
M. Jodoin, c’est en effet très clair que c’est une «ligne argumentative». C’est pas ce qu’on reproche au texte, de faire passer des «lignes argumentatives» pour de véritables citations.
Si ça se limitait à des trucs qu’on entend souvent (ex: « Ce n’est pas vrai qu’on ne peut plus rien dire » est en effet une ligne argumentative de la gauche) ça ne causerait pas de problème. Ce serait le cas aussi d’une généralisation du type «la gauche parle souvent du bien commun et fait la promotion de l’égalité plutôt que de la compétition». Pas besoin de citer 8 auteurices pour ça.
Mais:
«La CDB est une forme de justice réparatrice, concurrente à la justice traditionnelle.»
Désolé-e, j’ai vu ou entendu ça nulle part. J’ai jamais vu ça ne serait-ce que dans un commentaire sous une vidéo tiktok. Dans ce cas précis, il faut prouver qu’il s’agit d’une ligne argumentative de la gauche «néoprogressiste» – donc citer ses sources. Sinon, comme je l’ai écrit plus haut, d’un point de vue extérieur, ça ne peut que tomber dans le sophisme de l’épouvantail.
Merci pour votre réponse monsieur ou madame Umzidiu,
Je comprends bien ce que vous me dites et j’apprécie les précisions. Convenons tout de même d’une chose à propos de laquelle, je crois, nous pourrons nous entendre.
Initialement, on reprochait à l’auteure de ce texte « d’inventer des phrases », « d’imaginer ce que certaines personnes pensent », « d’inventer des citations » (ce sont vos mots) sans mentionner les sources. Elle « s’invente un idéaltype woke » ai-je même pu lire. Une telle manière de faire se situerait, en plus, sous la barre des compétences attendues d’un élève du secondaire, ai-je compris.
Maintenant, je constate en vous lisant que nous pouvons convenir qu’il est tout à fait acceptable et honnête intellectuellement de mentionner des lignes argumentatives communes et connues, qu’une telle pratique ne cause normalement « pas de problème » comme vous le dites bien, mais qu’une ligne mentionnée en particulier n’a pas d’assise dans le réel à votre connaissance, ce qui pourrait laisser entrevoir un argument peu satisfaisant.
Constatons qu’il y a un monde entre ces deux moments.
Dans le premier, on invalide carrément la méthode de bout en bout en dénonçant des inventions imaginées, ce qui ne laisse aucun espace pour discuter.
Dans le second, on pointe un problème qui mérite clarification, voire éventuellement une réfutation, ce qui ouvre la porte à un débat tout à fait légitime.
Comprenez en tout cas qu’à mon humble avis, pour ce qu’il vaut, le second moment a plus de chance d’être pris au sérieux. 🙂
Au plaisir.
Bonjour,
L’argument de la justice corrective ou réparatrice est en effet invoqué par la frange plus radicale (les néoprogressites ne forment pas un bloc homogène), qui considère que les groupes marginalisés ne bénéficient pas d’un accès équitable aux institutions (justice, santé, culture , éducation ), et ce, depuis des décennies, voire des siècles. Le bannissement serait donc un moyen légitime d’assurer un rééquilibrage symbolique du pouvoir. Cette pratique ferait partie d’un dispositif dans lequel on ménage un espace où les victimes demandent reconnaissance et réparation morale. Un exemple concret: pour ce courant, l’annulation de spectacles auxquels on reproche de faire de l’appropriation culturelle n’est pas considérée comme de la censure mais comme une réaction sociale à des injustices historiques et comme une volonté de mettre un frein à la reproduction, au sein des institutions culturelles, de rapports d’exploitation/domination/oppression. Les institutions culturelles ont d’ailleurs adopté des mesures dites réparatrices et correctives dans ce sens, à la suite de l’annulation des spectacles Slav et Kanata: des subventions conditionnelles à la prise en compte de la dimension EDI, des programmes dédiés aux artistes issus de groupes marginalisées etc. Ces mesures font l’objet de débats bien entendu, mais elle découlent clairement d’un appel à la réparation (réparer les injustices infligées aux cultures dites subalternes et la marchandisation de ces dernières). Sans prôner explicitement le bannissement, Stuart Hall par exemple, a posé les bases théoriques de cette ligne argumentative : la culture comme lieu de lutte, la légitimité des moyens radicaux quand ceux ci visent à corriger les dynamiques culturelles inégalitaires. Merci de vos commentaires et bonne journée.
Dans un registre équivalent, on peut citer les activités réservées aux personnes noires et afrodescendantes interdites aux blancs , une pratique dénoncée par ses détracteurs comme un bannissement des blancs , mais revendiquée comme un juste retour des choses pour corriger des siècles de ségrégation et d’exclusion des personnes noires par les blancs . Précisons toutefois qu’elle est parfois présentée comme une activité PÉDAGOGIQUE (de sensibilisation) destinée à susciter l’empathie (ressentir les effets de l’ostracisme) et parfois comme un acte POLITIQUE d’exclusion volontaire et réparatrice (c’est votre tour de goûter aux affres de l’exclusion) .
Bonjour
Ils ne s’agit pas de citations inventées mais de la ligne argumentative utilisée publiquement par les tenants de la culture du bannissement pour justifier cette pratique. Ils suffit de revisiter les controverses récentes autour de l’annulation de spectacles, de conférences ou même de personnalités, pour reconnaître les arguments clés que je reprends ici. Cette rhétorique se réclame de la pensée de Derrida, Bourdieu, Foucault ou Fanon et autres sur les dynamiques de pouvoir/domination et de reproduction de ces dynamiques, mais elle réduit et trahit hélas la pensée de ces auteurs en la vidant de ses nuances et de sa complexité. Quand on entend ces militants avancer que le bannissement est un corolaire de la liberté d’expression et qu’il faut s’attendre à être « critiqué » (ce qui signifie banni pour eux) quand on s’exprime, on est loin d’un débat éthique. Sans compter les ruses de la dialectique éristique, très prisées par les tenants de la CDB (par exemple, « inventer » des vices de forme pour tenter d’invalider un auteur sur le fond). Les mêmes qui essaient de trouver des failles méthodologiques dans une chronique en s’appuyant sur les critères de recherche, vont applaudir une thèse impressionniste quand celle-ci va dans leur sens. Difficile de débattre avec rigueur dans un tel contexte. Une ligne argumentative n’est pas une citation.
Vous parlez de « rhétorique », de « réduction » de la pensée des philosophes, d’arguments de « militants », de « ruse », mais des intellectuels sérieux ont écrit à ce sujet, ils ont justifié leurs positions par des arguments (Judith Lussier, Éric Fassin, Francis Dupuis-Déri, Monique Canto-Sperber, Pierre Tevanian, Stanley Fish, etc. et mon propre ouvrage si on me permet). On peut ne pas être d’accord avec eux, mais il n’aurait pas été difficile d’aller chercher de vrais arguments provenant de vraies sources, de manière à avoir un authentique dialogue. J’ai trouvé le texte bien argumenté dans son ensemble, j’aurais envie de critiquer certains points, mais ces critiques existent déjà et elles ont été ignorées.
La page «À propos» de ce site dit:
«le débat public se transforme en exercice où il suffit d’étiqueter et de classer dans sa petite case, le plus rapidement possible, toute personne qui se présente devant soi. (…) Il en va de même pour les idées, qu’il faut accepter ou rejeter à toute vitesse, comme s’il s’agissait de grenades. Dans le doute, il vaut mieux les ridiculiser et les relancer là d’où elles viennent. (…) Nous avons l’intuition optimiste d’être nombreux à avoir soif de réflexions et de discussions nuancées et à espérer retrouver des espaces d’échanges qui ne se transforment pas fatalement en luttes sans merci.»
Or, quand je lis les commentaires sous cet article, ce n’est pas ce que je constate. Je vois un lecteur amener un commentaire critique, certes, mais de manière très posée. Je vois le co-fondateur du site dire à ce lecteur qu’il le trouve «bien rigolo», qu’il «le fait un peu rire», qu’il «alimente le persiflage quotidien».
Cela me semble aller dans le sens inverse de l’approche proposée par Vaste Programme: on ridiculise les idées plutôt qu’avoir une discussion nuancée, alors que c’était justement ce que proposait le lecteur.
Est-ce que Simon Jodoin et Jérôme Lussier souhaitent réellement «retrouver un espace d’échange qui ne se transforme pas fatalement en une lutte sans merci» ? Lorsqu’une des personnes responsables d’un site se permet de ridiculiser des commentaires raisonnables parce qu’il n’est pas d’accord avec ceux-ci, cela ne donne pas l’impression qu’il est possible d’avoir des discussions respectueuses sur le site en question.
Salut,
Vaste est le programme. Bonne est l’idée de l’avoir mis au monde. Une promesse d’une pensée qui s’élabore sans précipitation. J’y retrouve des amis, une amie surtout, dont l’écriture agit comme un baume, lente, rigoureuse et précise. Elle écrit comme on éclaire, sans éblouir, avec une attention juste portée sur les choses et les êtres.
Son esprit critique veille, exigeant mais jamais dur, rigoureux sans être sec. Son style s’ancre dans une tradition académique assumée, et pourtant il s’en dégage une douceur rare, une manière d’accueillir la complexité sans la réduire. Une jumelle cosmique, une sœur de pensée, accordée à la même fréquence intime, regardant le monde depuis un point voisin, presque superposé. Cette proximité n’efface pas les différences, elle les rend fécondes.
Et pourtant tout commence à peine. Le programme avance à pas mesurés, encore fragile, encore exposé. Les défis sont grands et l’horizon se charge. Face à une droite qui se propage, qui s’installe, qui s’incruste dans les discours et les esprits, il ne suffit plus de commenter ou d’observer. Il faut tenir, penser, relier. Il faut un vaste programme, non comme un slogan, mais comme un espace de résistance patiente, un lieu où la pensée se rassemble pour ne pas céder, pour continuer à chercher, à nommer, à transmettre.