Richard Desjardins, Janette et tonton Miloud
Imaginez le casse-tête s’il fallait dresser la liste des personnalités sacrées et intouchables que tout Québécois qui se respecte se doit d’admirer
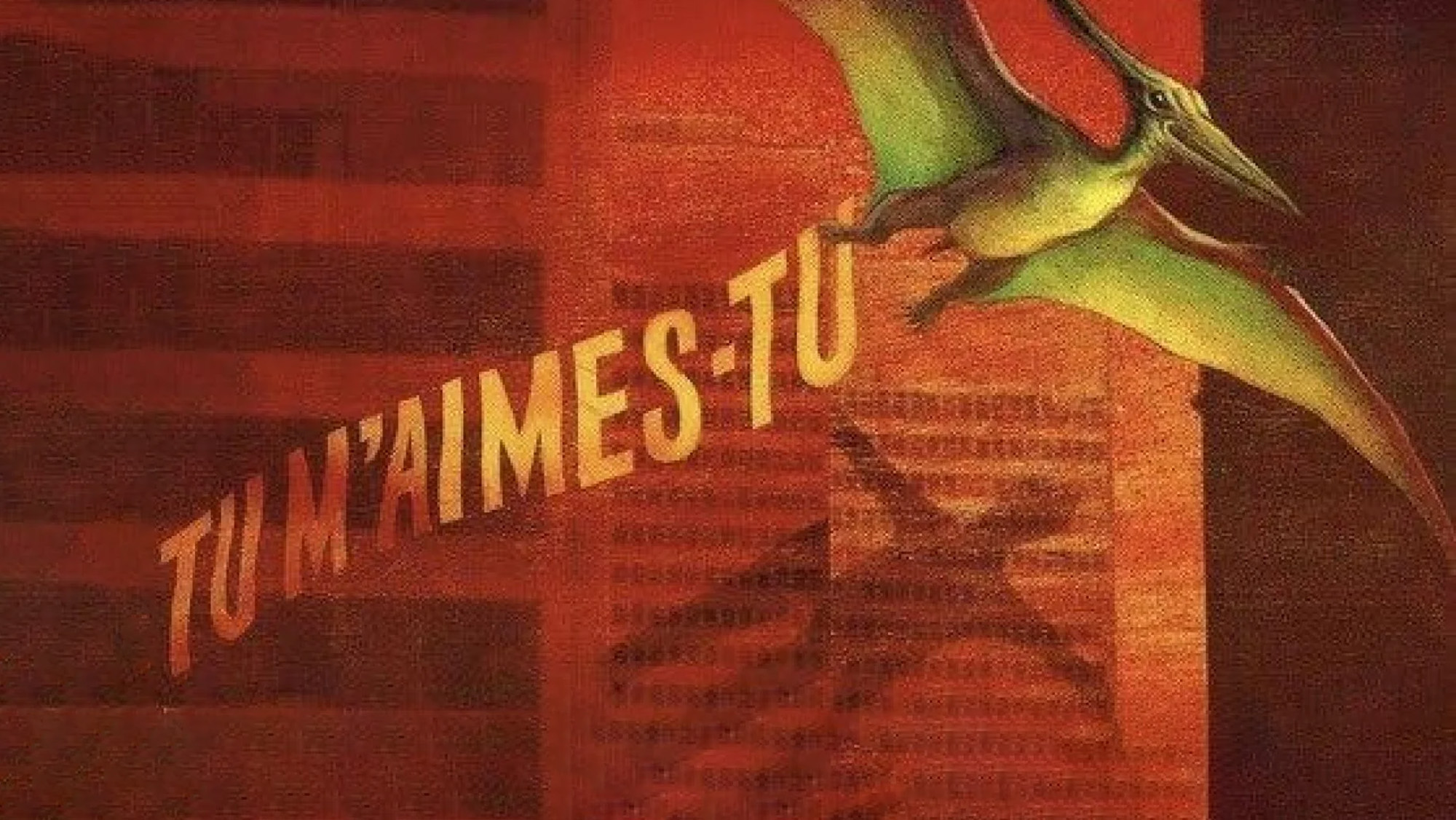
DE L’INTIME À L’UNIVERSEL
On est au début des années quatre-vingt-dix. Je viens d’assister au spectacle de Richard Desjardins avec son groupe Abitibi. Impossible d’échapper à Tu m’aimes-tu, un tube qui tourne sur toutes les radios.
Pour ma part, c’est la lame des paroles de la chanson Va-t’en pas qui me taillade les entrailles.
Quand j’étais sur la terre, sous locataire d’un kilo de futur, des monsieur incomplets-vestons, m’ont invité à une grande déception… Dehors j’ai vu un ciel si dur que tombaient les oiseaux… Va-t’en pas.
Quelques mois plus tôt, en 1989, je prenais un aller simple pour Montréal, à la recherche d’un kilo de futur à sous-louer. C’était la dernière fois que je voyais mon papa, décédé subitement et prématurément peu de temps après.
Encore toute remuée par la prose de Desjardins, je suis invitée chez des amis dans le quartier Rosemont où j’avais moi-même élu domicile, à deux pas du cinéma Dauphin (l’actuel cinéma Beaubien).
En plein élan desjardinmaniaque, je fus tancée par un convive, visiblement agacé par mon enthousiasme délirant. Ce beau ténébreux que je rencontrais pour la première fois décida de me fixer le squelette, me reprochant d’être prévisible, comme toutes ces personnes qui débarquent de France et s’extasient devant Desjardins parce que « ça transpire le terroir et le patois » et ça corrobore leur vision folklorique de la culture québécoise. « Tu l’as compris avec ou sans sous-titres ? » ironisa-t-il.
Je me gardai bien de lui avouer qu’à la fin des années quatre-vingt, alors étudiante en France, je dévorais la mini-série Le crime d’Ovide Plouffe, diffusée avec sous-titres sur une chaine publique française.
En revanche, je n’ai pas eu le temps et l’énergie pour expliquer à mon interlocuteur que la formule consacrée « partir de l’intime pour toucher à l’universel » n’avait jamais sonné aussi juste que durant ce concert de Desjardins.
En effet, par la magie des mots et de la mélodie, la confession murmurée de l’artiste résonnait si fort qu’elle finissait par susciter une mélancolie envahissante, telle une pluie d’automne qui cogne à la fenêtre un dimanche après-midi, comme pour nous arracher à l’ennui.
LA LIBERTÉ DE CHOISIR SES COUPS DE CŒUR, SES MODELES ET SES HEROS
Plusieurs années après le souper de Rosemont, j’ai de nouveau été prise à partie. Cette fois ci, on ne me reprochait pas d’aimer un chanteur québécois pour les mauvaises raisons (la condescendance des cousins) mais de ne pas aimer une figure importante du féminisme québécois contemporain, alors que j’aurais toutes les raisons de l’aimer.
« Tu es la seule personne que je connais qui n’aime pas Janette ».
En réalité je n’ai jamais affirmé ne pas aimer Janette, mais je considérais (un point de vue subjectif et personnel), dans la foulée des célébrations de son centième anniversaire, que des femmes comme Madeline Parent (décédée en 2012) ou Lea Roback (décédée en 2000) avaient autant, sinon davantage de mérite, dans leurs domaines respectifs, en matière d’avancement des droits des femmes et des populations vulnérables. À bien des égards, elles avaient fait sauter des verrous qui ont permis à d’autres, incluant Janette, d’ouvrir des portes et de pousser le combat plus loin. Ce que je contestais c’était la tendance à confisquer le statut de pionner et de pionnière et à accepter les lauriers en oubliant parfois de reconnaitre aussi l’apport de ceux et celles qui nous ont précédés.
L’argument massue ne tarda pas à tomber, comme un verdict sans appel : « en tous cas, nous ICI on lui doit beaucoup et on l’aime ».
Décidément, c’est le jour de la marmotte. Plus de trente ans plus tôt, alors que je travaillais comme chercheure pour le ministère de l’éducation et que j’animais une conférence devant des membres du personnel enseignant, dans un contexte très tendu entre le ministère et les acteurs de terrain, j’ai cru bon de détendre l’atmosphère en faisant une blague somme toute inoffensive sur la série télédramatique écrite par Janette, L’amour avec un grand A.
Le trémolo dans la voix, une enseignante se saisit du micro pour me signifier que j’étais bien impertinente de traiter avec autant de désinvolture, en tant que jeune femme à peine sortie de l’adolescence et en tant que française, l’œuvre d’une grande dame à laquelle je devais beaucoup sans le savoir (dis donc , chaque fois que je commets une boulette, ce sont mes « ancêtres les gaulois » qui ramassent la facture). Janette avait été nommée femme du siècle en 1990.
La possibilité d’avoir un avis dissonant sur une icône… et si c’était ça, la fameuse inclusion qu’on nous récite comme un mantra, souvent pour prêcher la chose et son contraire ?
Si c’était la liberté de choisir ses héros, ses héroïnes ou ses coups de cœur et de défendre ses choix avec des arguments rationnels ou affectifs, sans être bâillonné par l’argument des origines ?
La possibilité de dire, sans marcher sur des œufs, qu’on est pulvérisé par les mots de Richard Desjardins ou de David Goudreault, chaviré par le cri étouffé de Lhasa De Sela ou la voix suave de Nicole Martin, mais insensible à la puissance olympique de la voix de Céline.
Le loisir de déclarer, même en tant que personne dite issue de la diversité, qu’on ne raffole pas d’un certain humour ethnique prévisible avec ses vedettes emblématiques, chouchous du public et des médias, son répertoire de clichés un tantinet moralisateurs, qui n’ont plus rien de subversif : accents forcés, anecdotes stéréotypées sur les parents, les douaniers qui déforment votre nom ou cherchent une bombe dans votre trousse de toilette, etc.
D’ajouter qu’à cet humour de confort et de séparation, on préfère un humour de déconstruction, comme la formidable série Pure laine, dans laquelle tout le monde en prenait pour son grade ; l’auteur tordait les clichés pour les retourner contre eux-mêmes et finissait par créer une connivence horizontale, chacun reconnaissant une part de lui-même dans l’autre.
On peut n’avoir pas grand-chose à écrire sur le livre d’or « ce que je dois à Janette » (sans rien enlever à cette personnalité méritante, aimée et respectée du public), tout en étant rempli de gratitude envers Madeleine Parent et d’admiration envers les sept femmes avant-gardistes, signataires du Refus Global (en 1948 !), qui ont payé le prix fort pour ce geste subversif, et ce, sur tous les plans : professionnel, familial, social, politique et psychologique.
Et on ne parle ici que de pionnières femmes, issues du groupe majoritaire, dont les combats ont des retombées positives aujourd’hui sur tous les aspects de notre vie quotidienne, quelles que soient notre génération, notre condition socio-économique, notre identité de genre ou notre origine ethnique.
Imaginez le casse-tête s’il fallait dresser la liste des personnalités sacrées et intouchables que tout Québécois qui se respecte se doit d’admirer et d’AIMER !
Imaginez la foire d’empoigne quand il faut s’entendre sur une liste dite inclusive, qui exige un travail de dosage homéopathique en vue d’assurer une juste représentation de toutes les composantes sexuelles, générationnelles, ethniques, les sensibilités idéologiques et politiques : bonjour la mesquinerie, les règlements de comptes, les oublis volontaires, les héros sortis de nulle part, le copinage et la tentation du chacun prêche pour sa paroisse.
Du reste, il ne s’agit pas d’aimer ou de ne pas aimer. Rien à voir non plus avec la loyauté envers le peuple accueillant, la méconnaissance, la valorisation ou le mépris de la culture d’accueil.
Il ne s’agit pas d’un concours de popularité ou de mérite. En matière de reconnaissance de ceux et celles qui nous ont pavé la voie, inspirés ou émus, l’injonction n’a pas sa place. Les parcours de vie sont de plus en plus éclectiques, les sources d’inspiration multiples et les chemins de traverse empruntés par certains individus ne permettent plus d’installer des statues et des figures imposées devant lesquelles tous les passants doivent s’incliner en même temps.
Prenons Guy Rocher, dont on a célébré modestement les 100 ans en 2024[1]. Cet artisan de la Revolution Tranquille, monument de la scène intellectuelle québécoise, a eu droit à quelques entrevues ici et là, un colloque organisé conjointement par l’UQAM et la Fédération des CEGEP et un cahier spécial paru dans Le Devoir.
En tant qu’actrice et observatrice de la scène éducative, intellectuelle progressiste très attachée à l’égalité des chances, ex-membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, c’est son nom qui me vient en tête quand on m’interroge sur les personnalités québécoises francophones pionnières dans leur domaine que j’affectionne et qui m’inspirent.
Il y a aussi Émile Ollivier, trop discret et trop vite oublié à mon sens, reconnu comme écrivain mais dont le travail colossal en faveur de l’éducation des adultes demeure méconnu et sous-estimé alors qu’un prix portant son nom est décerné chaque année.
C’est mon palmarès personnel et il ne me viendrait pas à l’esprit de l’imposer à des personnes qui ont un autre parcours, d’autres intérêts et une autre histoire que la mienne. Mais je devrais pouvoir le défendre ou en discuter sans être invalidée sur une base ethnique.
Il en est de même pour les artistes qui nous font vibrer. C’est d’abord une affaire de tripes, de mémoire affective ravivée, de joies et de douleurs qui remontent à la surface après avoir traversé un océan et des frontières que l’on croyait étanches.
C’est exactement ce qui s’est produit lors du spectacle de Richard Desjardins auquel je faisais allusion au début de ce texte. Alors que l’artiste entamait les premières notes de la chanson Tu m’aimes-tu, recroquevillé sur son piano, j’ai cru apercevoir sur scène la silhouette familière d’un homme penché, marchant avec difficulté, avançant vers le chanteur et se saisissant d’un micro pour prendre part à la complainte. Tonton Miloud !
LE CHAGRIN D’AMOUR DE TONTON MILOUD
C’était le cousin germain de maman. Les séquelles d’une poliomyélite contractée en bas âge donnaient à sa démarche hésitante une grâce singulière. Il ne boitait pas, il esquissait un pas de danse.
Quand il nous rendait visite avec sa tell’ment tell’ment tell’ment belle Fatéma, toute la famille s’empressait de les accompagner vers la porte pour ne pas rater le rituel de leur départ.
Fatéma secouait sa crinière, soulevait sa jellaba fendue sur le côté pour démarrer la moto vintage qui avait l’air d’une réplique de la Norton sur laquelle le Che a entrepris son voyage à travers l’Amérique du Sud en 1952. Une atrophie des membres inférieurs limitait les mouvements de Miloud et l’empêchait de donner le coup de kick, mais c’est lui qui conduisait la moto.
Ah Fatéma ! Souveraine, élancée, incandescente ; chacun de ses pas semblait étirer le temps et son élégance naturelle occupait tout l’espace, comme un paquebot géant dans la chambre à coucher.
Ils étaient complices et complémentaires dans leur solitude, lui replié sur ses illusions et elle sur ses mystères, leurs deux mondes reliés par un passage secret que Fatema ouvrait d’un geste sec en appuyant sur la pédale, avant de s’installer derrière son homme en l’enlaçant.
Tonton Miloud aimait passionnément la marmaille et savait s’y prendre pour apprivoiser les plus farouches d’entre nous. Drôle, taquin, enjoué, un homme-enfant irrésistible.
Un samedi, Tonton est venu sans Fatéma. Au fond de ses beaux yeux couleur de miel, on pouvait apercevoir une scène de film catastrophe qui se passait de sous titres. Au moment du départ, c’est papa qui mit la moto en marche.
La langue est le seul organe sans os qui peut briser tous les os. Et les langues sales dansèrent la claquette sur les tuiles fissurées de la cuisine abandonnée de Miloud et Fatéma. Les rumeurs s’enchevêtrèrent comme des fils électriques dénudés.
Elle était tombée enceinte d’un autre homme, Miloud ne pouvant lui donner un enfant à cause de son infirmité, murmuraient les uns.
Mais non ! Il l’a sortie de la pauvreté mais elle a fini par espérer davantage qu’un mariage arrangé avec un homme diminué et plus âgé qui la gâtait comme le ferait un papa ; pour moi t’es une prisonnière en permission, qu’importe le partenaire, j’dois être le vrai portrait de ton père.
Vous n’y êtes pas du tout ! Elle a fui en Europe avec un Français, ou peut-être un Italien ou un Espagnol… bref, un Nazaréen adepte de l’orientalisme érotisé, qui conçoit le corps féminin arabe comme un territoire à conquérir.
C’est ainsi que le cœur brisé de Miloud et le théâtre secret de Fatema devinrent un champ d’études postcoloniales (plus ça change plus c’est pareil n’est-ce pas ?).
Et si c’était plus simple et plus désespérant de banalité ? Une histoire d’amour et d’abandon, un nuage rose sur lequel la reine Fatema avait pris place, laissant échapper au décollage des gouttes de pluie acide qui ont coulé sur Miloud jusqu’à le dissoudre.
Les visites de tonton Miloud se firent de plus en plus rares avant de cesser tout court. Impossible à joindre ni même à localiser.
Jusqu’au jour où il fut retrouvé mort dans son entreprise, la station-service qui était devenue son refuge.
Là encore les langues se déchaineront : un suicide ? Un excès d’alcool ? Un hold-up qui a mal tourné ?
Tonton Miloud s’est éteint, consumé par l’absence de Fatéma. Cette vie qu’il aimait tant ne lui a pas rendu la politesse, sinon en lui offrant une compagne, une flamme dans la nuit, un cadeau d’la mort, qui a donné des coups d’accélérateur à son cœur et à sa moto mais qui a eu envie un jour de changer de personnage.
___________________________
[1] Le décès de Guy Rocher a été annoncé après la rédaction de ce texte.
Rachida Azdouz est psychologue, autrice et chroniqueuse. Chercheure affiliée au LABRRI, son programme est modeste : résister aux injonctions, surveiller ses angles morts, s'attarder aux frontières et poursuivre sa quête.
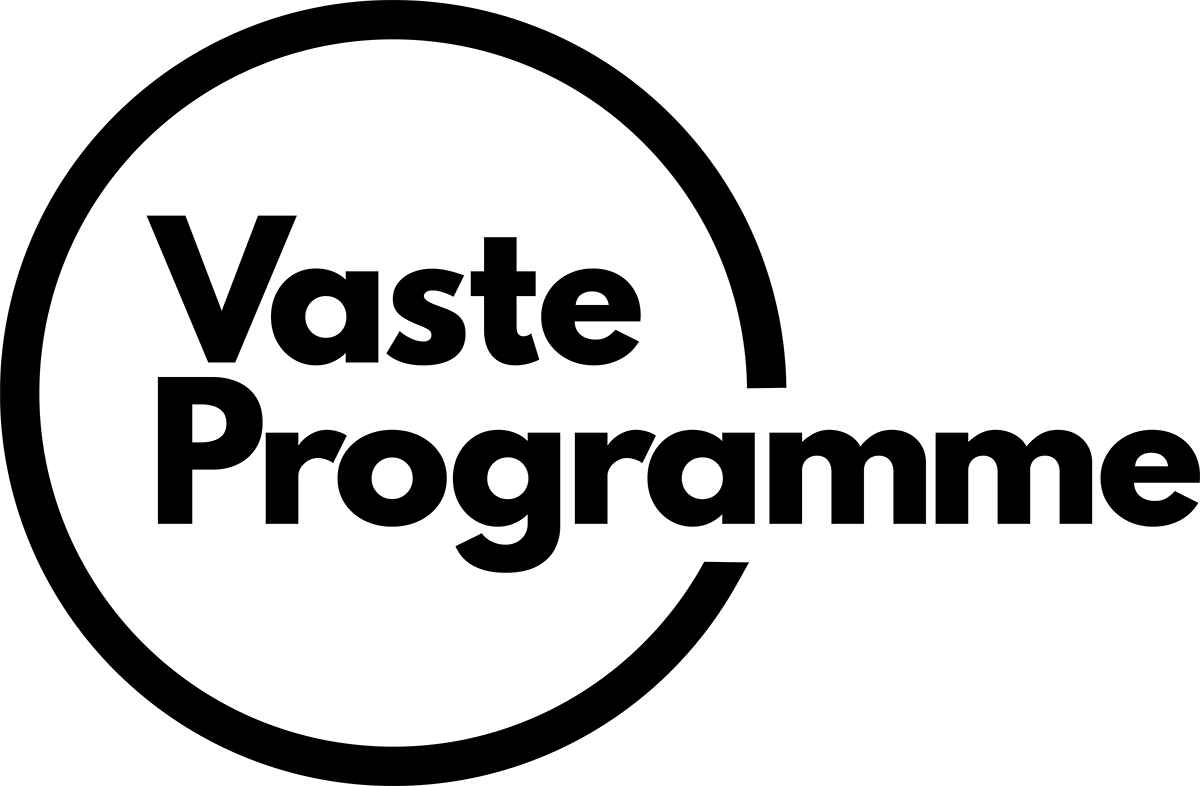
Avant de commenter ou de participer à la discussion, assurez-vous d'avoir lu et compris ces règles simples